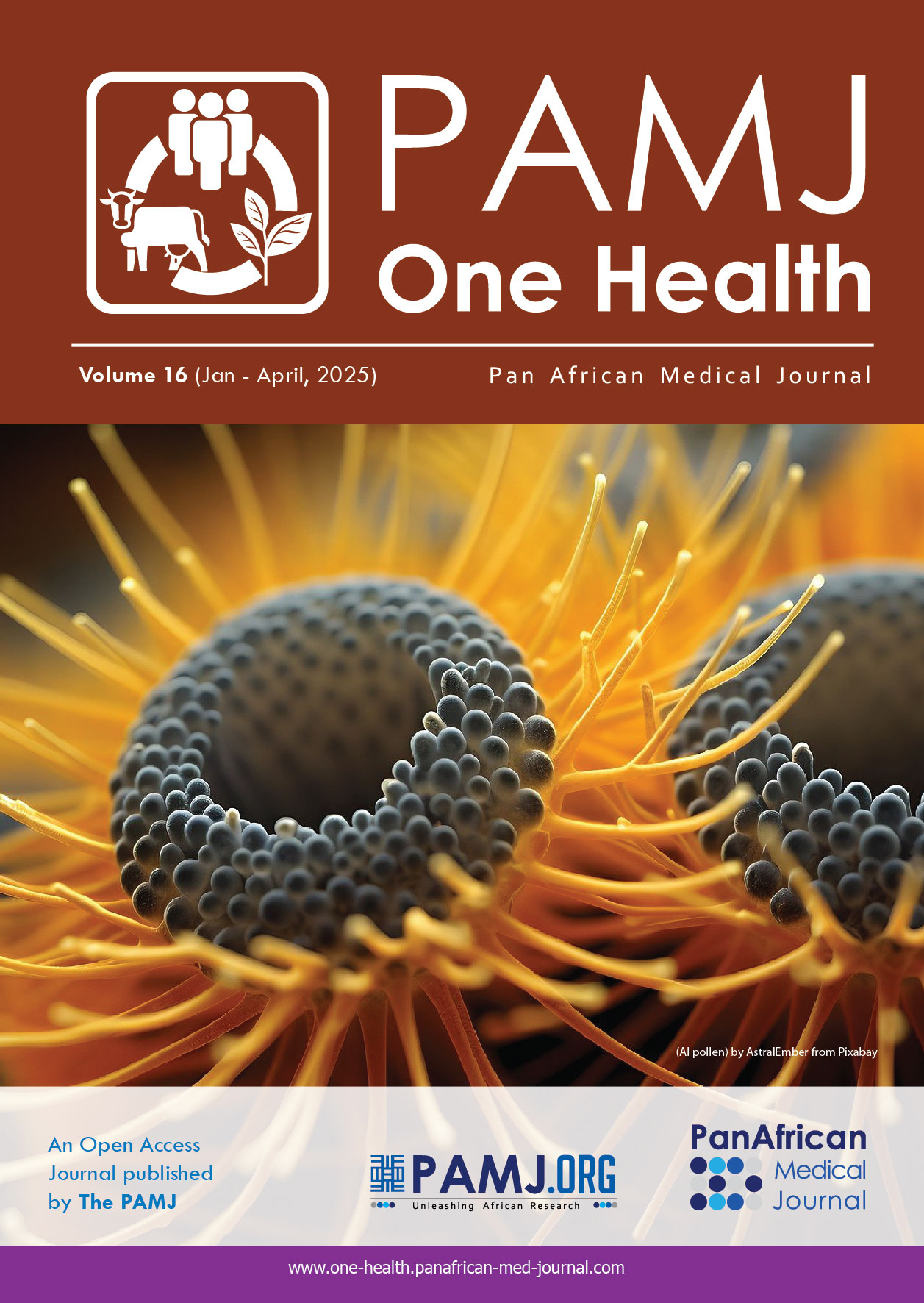Etude de cas-témoin des inégalités et choix en santé sexuelle et reproductive chez les personnes en situation de handicap porteuses du VIH/SIDA et les Personnes porteuses du VIH/SIDA dans le centre de traitement agréé de l´Hôpital des instructions armée de Cotonou
Alvine Stéphanie Nteppe, Vincent Tiffreau, Paraïso Noël Moussiliou
Corresponding author: Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey Calavi, Cotonou, Bénin| Université de Lille, Lille, France 
Received: 23 Sep 2024 - Accepted: 14 Dec 2024 - Published: 28 Mar 2025
Domain: Epidemiology,HIV epidemiology,Population Health
Keywords: Inégalités, santé sexuelle et reproductive, PHVVIH
©Alvine Stéphanie Nteppe et al. PAMJ-One Health (ISSN: 2707-2800). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution International 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Cite this article: Alvine Stéphanie Nteppe et al. Etude de cas-témoin des inégalités et choix en santé sexuelle et reproductive chez les personnes en situation de handicap porteuses du VIH/SIDA et les Personnes porteuses du VIH/SIDA dans le centre de traitement agréé de l´Hôpital des instructions armée de Cotonou. PAMJ-One Health. 2025;16:10. [doi: 10.11604/pamj-oh.2025.16.10.45424]
Available online at: https://www.one-health.panafrican-med-journal.com/content/article/16/10/full
Research 
Etude de cas-témoin des inégalités et choix en santé sexuelle et reproductive chez les personnes en situation de handicap porteuses du VIH/SIDA et les Personnes porteuses du VIH/SIDA dans le centre de traitement agréé de l´Hôpital des instructions armée de Cotonou
Etude de cas-témoin des inégalités et choix en santé sexuelle et reproductive chez les personnes en situation de handicap porteuses du VIH/SIDA et les Personnes porteuses du VIH/SIDA dans le centre de traitement agréé de l'Hôpital des instructions armée de Cotonou
Inequalities and choices in sexual and reproductive health among people with disabilities and HIV/AIDS: the case of the approved treatment center (ATC) of the Army Instruction Hospital (AIH) in Cotonou
Alvine Stéphanie Nteppe1,&, Vincent Tiffreau1, ![]() Paraïso Noël Moussiliou1
Paraïso Noël Moussiliou1
&Auteur correspondant
Introduction: il s'agissait d'une étude de cas-témoin des personnes handicapées et des personnes non handicapées vivantes avec le VIH/SIDA de l'unité de prise en charge (UPEC) au VIH de l'Hôpital des Instructions Armées de Cotonou (HIA). Nous étions tenus d'étudier la résilience de la personne en situation de handicap porteuse du VIH/SIDA (PHVVIH) sur ses droits sexuel et reproductif malgré le VIH et son handicap. La PHVVIH a été appariée en genre et en âge avec la PVVIH afin de calculer la fréquence des variables liées à sa résilience face aux inégalités sur ses droits sexuels et reproductifs malgré le VIH et son handicap.
Méthodes: le questionnaire préalablement élaboré et orienté par les capabilités au-delà des variables recherchées intégrait un consentement éclairé et un screening du handicap conventionnel et du handicap selon la classification internationale du fonctionnement (CIF). Les données collectées et complétées à l'aide des dossiers des malades et des rapports du médecin de l'UPEC de l'HIA ont été utilisées dans des feuilles Excell avant d'être traitées avec le logiciel SPSS.
Résultats: il en ressort que 93,75% des PVVIH et 100% des PHVVIH avaient connaissance du VIH; 75% des PVVIH et 68,75% des PHVVIH avaient connaissance des services de paquet d'interventions spécifiques (PTME); 25% des PVVIH et 31,25% des PHVVIH désiraient avoir des enfants; 43,75% des PVVIH et 75% des PHVVIH étaient sexuellement actives or seulement 31,25% des PHVVIH utilisaient les méthodes contraceptives; 71,44% des PVVIH et 66,68% des PHVVIH utilisaient des préservatifs masculins/féminins et 18,75% des PVVIH étaient survivantes de violence basée sur le genre (VBG).
Conclusion: l'orientation de l'étude par les capabilités a favorisé une meilleure compréhension de la résilience et des choix en santé sexuelle et reproductive de la PHVVIH et de la PVVIH appariées de l'HIA. Toutefois, il serait susceptible de mettre en évidence des interventions hautement ciblées autour de la PHVVIH afin de leur assurer une meilleure prise en charge dans les services PTME, planning familial et de santé sexuelle et reproductive (SSR).
Introduction: we conducted a case-control study to examine the sexual and reproductive health of people with disabilities living with HIV (DPLWHIV) and gender-and age-matched controls living with HIV (PLWHIV) at the HIV Care Unit of the Army Instruction Hospital of Cotonou (AIH). Methods: a questionnaire including an informed consent, a conventional disability screening and a disability screening according to the International Classification of Functioning (ICF), was administered to both PWDLHIV and matched PLHIV. Data collected, sometimes supplemented using patient files and reports from the UPEC physician at HIA, were entered into Excel sheets before being processed using SPSS software. Results: about 93.75% of PLHIV and 100% of PWDLHIV were aware of HIV; 75% of PLHIV and 68.75% of PWDLHIV were aware of Prevention of Mother-to-Child Transmission (PMTCT) services; 25% of PLHIV and 31.25% of PWDLHIV expressed the desire to have children; 43.75% of PLHIV and 75% of PWDLHIV were sexually active, yet only 31.25% of PWDLHIV used contraceptive methods; 71.44% of PLHIV and 66.68% of PWDLHIV used male or female condoms; 18.75% of PWDLHIV had experienced gender-based violence (GBV). Conclusion: a capability-oriented approach to the study facilitated a better understanding of contraceptive choices and their use among PWDLHIV at HIA. However, it also highlighted the need for highly targeted interventions to ensure improved access to PMTCT services, family planning and sexual and reproductive health (SRH) care for PWDLHIV.
Key words: Inequalities, sexual and reproductive health, DPLWHIV
Les obstacles à la prise en charge des personnes handicapés vivantes avec le VIH dans l'unité de prise en charge de l'Hôpital d'Instructions Armées (HIA) de Cotonou peuvent entrainer des privations et des inégalités de capacités dans le domaine de la santé sexuelle reproductive. Ces obstacles influencent sur les capacités de participation et d'intégration sociale des personnes vivantes avec le VIH (PVVIH) en général et des personnes handicapées vivantes avec le VIH (PHVVIH) en particulier dans le centre de l'HIA. Ils créent par la suite des inégalités dans la gestion des droits sexuels et reproductifs de celles-ci. Ces inégalités de capacités peuvent être liées à l'inégalité des soins; l'inaccessibilité des centres de traitement agréés (CTA); à la non-participation aux activités 95-95-95 de l'ONUSIDA; aux pertes de vus et absences des PVVIH en général; à l'incidence des coïnfections; à la létalité; aux préférences de méthodes contraceptives et des services de prise en charge contre la transmission mère et enfant (PTME); au refus d'intégration sociale; à l'absence de désir de procréer et de former une famille. Les conférences HDCA 2023 et 2024 ont été des occasions de présenter les résultats des études qualitative et quantitative sur l'évaluation par l'approche par les capabilités des facteurs associés à la capabilité et à la connaissance de la santé sexuelle et reproductive chez la PHVVIH et la PVVIH appariée. Cette recherche est une étude qui facilite premièrement la compréhension de la résilience de la PHVVIH dans la gestion de ses droits sexuels et reproductifs malgré son handicap et le VIH/SIDA. Deuxièmement, elle a permis d'analyser les préférences et l'utilisation des méthodes contraceptives chez les PHVVIH et les PVVIH appariées en genre et en âge dans le site de prise en charge de l'HIA de Cotonou. Des variables sur la prise des antirétroviraux (ARV), sur le suivi de la charge virale (CV), sur le test sérologique, sur l'intégration des activités 95-95-95 de l'ONUSIDA dans le site, sur le désir de procréer, sur l'intégration familiale et l'intégration sociale, sont des variables que nous avons souhaité analyser et mesurer afin de décrire la capabilité des PHVVIH et des PVVIH. Cette capacité a facilité la compréhension de la résilience de la PHVVIH et la PVVIH face à la connaissance de leur droit sexuel ou reproductif malgré le handicap ainsi que le VIH; d'analyser leur engagement à vivre une vie sexuelle et reproductive épanouie malgré les obstacles à la prise en charge globale des PVVIH. L'approche par les capacités mettra cependant en évidence la résilience et les préférences en santé sexuelle et reproductive au sein des populations cibles.
Nous avons mené une étude quantitative de cas témoins au sein du centre de traitement agréé des PHVVIH et des PVVIH à l'HIA de Cotonou. Cette étude transversale s'est tenue en août 2023. Nous avions comme cible de l'étude quantitative les PHVVIH ayant un handicap moteur, visuel, psychologique et également ayant des handicaps visibles selon la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF). Un questionnaire unique a été adressé à la PHVVIH et à la PVVIH appariées. Etaient intégrés dans le questionnaire un consentement éclairé à participer à l'étude et un screening du handicap conventionnel et du handicap selon la CIF chez les deux populations de notre étude.
Participants: étude de cas-témoin transversale, nous avions comme cas de l'étude les PHVVIH et comme témoins de l'étude, les PVVIH de l'UPEC de l'HIA de Cotonou. Les PHVVIH ont été recherchées parmi les PVVIH liées à notre site d'étude à l'aide de leur dossier thérapeutique et du screening des PVVIH affectées par les maladies de la classification internationale de la CIF. Les informations démographiques et psychomédicales de PHVVIH obtenues, nous avons apparié nos cas à des témoins PVVIH ayant leur âge et étant de genre identique. Les PHVVIH ont été appariées en genre et en âge. Le suivi des données et la collecte s'est faite au sein de l'UPEC de l'HIA du CNHU de Cotonou en août 2023.
Critère d'inclusion: adolescents et jeunes handicapés porteurs du VIH; adolescents non handicapés porteurs du VIH. Les difféffrents types de handicap étaient: handicap moteur, visuel, psychologique et également PVVIH ayant des handicaps visibles selon la CIF. Nous avions également des sources de collecte de données telles que les rapports du point focal UPEC et dossiers thérapeutiques des PVVIH porteurs handicapés et porteurs non handicapés.
Critère d'exclusion: étaient exclues de l'étude toutes PHVVIH et PVVIH n'ayant pas donné son consentement à participer à l'étude; toute personne de l'Hôpital des Instructions Armées de Cotonou non prise en charge dans le centre de traitement agréé des personnes vivant avec le VIH; toutes PVVIH non-appariées aux PHVVIH en genre et en âge.
Collecte et gestion des données: les variables extraites et analysées étaient premièrement les caractéristiques sociodémographiques, les profils des personnes handicapées porteuses du VIH et des personnes non handicapées porteuses du VIH. Les résultats du traitement des données collectées nous ont permis d'analyser la connaissance des services de la PTME, les choix des moyens contraceptifs des PHVVIH et des PVVIH pour enfin analyser les facteurs sociaux en santé sexuelle et reproductive du suivi thérapeutique des personnes liées dans le CTA de l'HIA.
Variables: les variables recherchées étaient la connaissance du VIH, la connaissance des services de PTME, planning familial; le choix et l'utilisation des moyens contraceptifs; le nombre d'enfants après la sérologie positive au VIH et le désir d'en avoir malgré le VIH/SIDA. Variables indépendantes: la santé sexuelle et reproductive (SSR) des PHVVIH; Variables dépendantes: le handicap, l'utilisation des moyens contraceptifs et des services de PTME, capabilité à désirer des enfants, VBG, participation sociale, restriction sociale, nombre d'enfant, connaissance de la PTME.
Biais: la taille de l'échantillon des personnes handicapées porteuses du VIH bien qu'étant faible, nous avons collectées chez ces personnes plusieurs variables significatives qui ont été considérées comme des facteurs explicatifs des inégalités en santé sexuelle et reproductive chez les PHVVIH et les PVVIH appariées.
Taille de l'échantillon: la file active de l'HIA étant de 781 PVVIH nous avons screené un total de 25 PHVVIH dans le CTA. Nous avons obtenu 9 refus des PHVVIH à participer à l'étude. Nous avions administré 32 questionnaires aux PVVIH parmi lesquelless, les PHVVIH questionnées n= 16 et les PVVIH n'= 16 comme population témoin.
Méthodes statistiques: les résultats des données collectées de l'étude ont été obtenues avec SPSS. Notre étude ne visait pas la recherche d'association possible entre les différentes variables étudiées. Nous sommes passés par contre par un calcul de la fréquence des variables étudiées selon les deux populations d'étude avec un intervalle de confiance IC (p)= [73,07%; 85,44%]. Ce calcul de la fréquence des variables étudiées justifie les différents tableaux et dont les résultats sont représentés sous forme d'effectifs et de pourcentages cela, dans le cadre de l'étude de la résilience de la PHVVIH dans la gestion de ses droits sexuel et reproductif malgré son handicap et le VIH/SIDA. Le test statistique utilisé est le calcul de la fréquence de la variable connaissance du VIH, connaissance des services de PTME, planning familial, choix et utilisation des moyens contraceptifs, nombre d'enfants après la sérologie positive au VIH et la variable désir d'avoir des enfants malgré le VIH/SIDA. Tous ces résultats sont présentés sous forme de tableaux présentant des fréquences ainsi que des pourcentages des variables des deux populations de l'étude.
Considération éthique: les outils de collecte étaient accompagnés d'un consentement éclairé. Nous avions obtenu des clairances éthiques de l'Institut Régionale de la Santé Publique sous la couverture de l'Université d'Abomey Calavi N°009-2022/IRSP/S-FORD. A l'aide de cette lettre, nous avons obtenu des lettres d'autorisation de l'Hôpital d'Instructions Armées de Cotonou avec les numéro d'approbation respectifs N°22-442HIA-CHU-C/GEST/SAG/SLRH/SA et le N°23-1383/DCSSA/CAB/BEO/DFS/SA.
Inégalités et choix en santé sexuelle et reproductive
La PVVIH au-delà de son handicap a conscience de sa santé sexuelle et reproductive vu que l'âge moyen des PHVVIH et PVVIH étudiées est de 49 ans; l'âge minimal de 22 ans et l'âge maximal de 63 ans. Il s'agit des personnes concernées par des questions de santé sexuelle et reproductive afin de répondre à leur besoin de fonder une famille, d'avoir des enfants et où d'avoir un désir sexuel passager. La PHVVIH semble mieux avoir connaissance du VIH/SIDA que la PVVIH. Pratiquement 93,75% des PVVIH connaissent de quoi ils sont atteints, les causes et les conséquences du VIH/SIDA ce que les PHVVIH questionnées stipulent tous connaître. Une majorité de 75% des PVVIH et 68,75% des PHVVIH ont déjà eu à bénéficier d'un service de la PTME et pour la plupart lors des grossesses et accouchement de leurs enfants. Tous les PHVVIH questionnées ont tous eu des enfants et seulement 81,25% des PVVIH ont eu des enfants. Près de 31,25% des PHVVIH désirent avoir des enfants or seulement 25% des PVVIH désirent avoir des enfants. Soixante quinze pourcent (75%) des PHVVIH et 43,75% des PVVIH sont sexuellement actifs et seulement 31,25% des PHVVIH utilisent des moyens contraceptifs au détriment de 43,75% chez les PVVIH. Ces proportions vont de paires et expliquent pourquoi la proportion des PHVVIH qui désirent avoir les enfants est plus élevée. La PHVVIH a en moyenne 4 enfants par personne et chez la PVVIH la proportion d'enfant dans un foyer est de deux enfants. Afin d'évaluer la capabilité négative des PHVVIH face au désire d'enfants malgré leur statut sérologique positif au VIH/SIDA et leur handicap, l'indicateur qui renseigne sur les enfants procréés avant et après le statut sérologique a été exploité. Nous avons reçu comme résultat 62,50% de PHVVIH ayant procréé après leur statut séropositif et 37,50% des PHVVIH ayant procréé avant leur statut séropositif au VIH/SIDA.
Connaissances sur la santé sexuelle et reproductive
Connaissances sur la santé sexuelle et reproductive chez la population des PVVIHs
La majorité soit 93,75% des PVVIH ont une connaissance du VIH. Ceux-ci se sont intéressés à l'atteinte qu'ils portent et au message du counselling afin de vivre en santé avec une charge virale supprimée. Soixante-quinze pourcent (75%) des PVVIH ont connaissance des services de PTME. La plupart ont connu ce service lors de l'enfantement d'une de leurs progénitures. Un peu plus de 81,25% des PVVIH ont en moyenne 4 progénitures. La variation de progénitures chez les PVVIH sont d'un enfant au minimum et de 10 enfants au maximum. Vingt-cinq pourcent (25%) de ces PVVIH désirent avoir des enfants et parmi eux certains qui en avaient déjà eu. Autour de 43,75% des PVVIH sont sexuellement actifs et 56,25% ne le sont pas. Les 43,75% des PVVIH sexuellement actifs utilisent les méthodes contraceptives. Les types de contraceptifs utilisés par ces PVVIH sexuellement actives sont les préservatifs utilisés par 71,44%; les préservatifs, les pilules, les implant et les injections contraceptives sont des méthodes contraceptives utilisées à la fois par 14,28% des PVVIH sexuellement actifs ainsi que les préservatifs et implant contraceptifs utilisés à la fois par 14,28% des PVVIH sexuellement actifs. La PVVIH étudiée n'est pas très libérale concernant sa santé sexuelle et reproductive. Les PVVIH ont plus d'enfants par famille mais nombreux n'ont pas fait le choix de faire des enfants. La plupart craignent de faire des enfants malades et s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants pour celles qui en ont fait. Nous avons rencontré des cas où la PVVIH avait parmi ses enfants sains un enfant malade. Nous notons également une limitation dans la participation des objectifs de l'ONUSIDA par les PVVIH comparé à la PHVVIH qui est ouverte aux informations liées à sa prise en charge et s'implique dans toutes les activités de l'UPEC de l'HIA. Ce qui démontre une preuve concrète de leur résilience (Tableau 1). Les PVVIH qui ont été appariées aux PHVVIH de l'étude ont eu au total 60 progénitures avec une moyenne de 4 progénitures par PVVIH. Les PVVIH avaient au minimum une progéniture par personne porteuse du VIH et au maximum dix progénitures par personne porteuse du VIH (Tableau 2).
Connaissances sur la santé sexuelle et reproductive chez la population des PHVVIHs
Les résultats de l'enquête quantitative de notre thèse montrent que toutes les PHVVIH ont une connaissance du VIH. Celles-ci sont intéressées à l'atteinte qu'elles portent et au message du counseling afin de vivre en santé avec une charge virale supprimée malgré leur handicap. Autour de 68,75% des PVVIH ont connaissance des services de PTME. Les PHVVIH ont pour la plupart 4 progénitures en moyenne. La plupart ont connu ce service lors de l'enfantement d'une de leurs progénitures. Tous les PHVVIH ayant eu des enfants ont au moins une progéniture et au plus 6 progénitures. La variation de progénitures chez les PVVIH sont d'un enfant au minimum et de 6 enfants au maximum. A peu près 31,25% des PHVVIH désirent en avoir d'avantages et 68,75% n'en désirent plus. Soicante-quinze pourcent (75%) sont sexuellement actifs mais seulement 31,25% utilisent des moyens contraceptifs. La majorité soit 68,75% des PHVVIH non sexuellement actifs n'utilisent pas de moyens contraceptifs. Certains parmi eux n'ont pas répondu à cette question vu leur âge et leur état grabataire. Les PHVVIH sexuellement actives utilisent les moyens contraceptifs tels que les préservatifs masculin et féminin pour 66,68% de PHVVIH. A peu près 43,75% des PVVIH sexuellement actifs utilisent les méthodes contraceptives. Il est annoté que les hommes et les femmes par voie de communication avec leur partenaire arrivaient à répondre à la question concernant l'utilisation des moyens contraceptifs, d'où le résultat précédent. Un pourcentage de 16,66% des PVVIH sexuellement actifs utilisent en même temps les préservatifs masculin/féminin, les implants contraceptifs, les injections contraceptives. Autour de 16,66% des PHVVIH sexuellement actifs utilisant uniquement les injections contraceptives étaient des femmes. Les PHVVIH ont une meilleure connaissance de leur santé sexuelle et reproductive que les PVVIH et ont toutes eu une progéniture malgré le VIH et leur handicap. La plupart sont sexuellement actives et ont un fort désir d'avoir d'avantage des progénitures. Peu utilisent des moyens contraceptifs et sont facilement acceptées dans leur relation. Il s'agit pour la plupart des personnes avec une charge virale indétectables et qui font des choix pour vivre la vie qu'elles auraient raison de valoriser malgré le VIH et le handicap (Tableau 3). Les PVVIH qui ont été appariées au PHVVIH de l'étude ont eu au total 32 progénitures avec une moyenne de 3 progénitures par PVVIH. Les PVVIH avaient au minimum une progéniture par personne porteuse du VIH et au maximum six progénitures par personne porteuse du VIH (Tableau 4).
Facteurs sociaux en santé sexuelle reproductive associés au suivi thérapeutique
Autour de 59,38% des PHVVIH et PVVIH appariées sexuellement actives ont 56% de chance de bénéficier d'un meilleur suivi thérapeutique or 40,62% des PHVVIH et PVVIH non sexuellement actives ont seulement 44% de chance de bénéficier d'un bon suivi thérapeutique; 59,38% des PHVVIH et PVVIH appariées et sexuellement actives ont 71,43% de chance de ne pas bénéficier d'un meilleur suivi thérapeutique or 40,62% des PHVVIH et PVVIH non sexuellement actives ont seulement 28,57% de chance de ne pas bénéficier d'un meilleur suivi thérapeutique. Il n'existe pas de différence significative entre le caractère sexuel actif ou non actif des PHVVIH et PVVIH appariées en fonction de la qualité du suivi thérapeutique. Un peu plus de 28,13% des PHVVIH et PVVIH appariées désirant avoir des enfants ont 56% de chance de bénéficier d'un meilleur suivi thérapeutique or 71,87% des PHVVIH et PVVIH n'ayant aucun désir de procréer ont 72% de chance de bénéficier également d'un meilleur suivi thérapeutique. Dans les 28,13% des PHVVIH et PVVIH appariées qui désirent avoir des enfants, 28,57% ne peuvent pas bénéficier d'un bon suivi thérapeutique or parmi les 71,87% des PHVVIH et PVVIH n'ayant aucun désir de procréer, 71,43% ne bénéficieraient pas d'un meilleur suivi thérapeutique. Ce résultat montre qu'il n'existe encore aucune corrélation entre le choix d'être actif sexuellement et la qualité du suivi thérapeutique chez les PHVVIH et PVVIH du CTA de l'HIA. Soixante-quinze pourcent (75%) des PHVVIH et PVVIH qui ont des enfants ont 76% de chance de bénéficier d'un bon suivi thérapeutique et 71,43% de possibilité de ne pas bénéficier d'un meilleur suivi tri thérapeutique. Les autres 25% des PHVVIH et PVVIH appariées qui n'ont pas d'enfants ont 24% de chance de bénéficier d'un bon suivi tri thérapeutique et 28,57% de ne pas en bénéficier. Il n'existe aucune corrélation entre les PHVVIH et les PVVIH appariées ayant une progéniture où pas et la qualité de leur suivi thérapeutique. Nous irons plus loin en disant que la fécondité n'impacte en rien le suivi thérapeutique chez les PHVVIH et PVVIH. Les facteurs sociaux liés au suivi thérapeutique ne montrent pas de différence significative en ce qui concerne le fait d'être sexuellement actif, de désirer avoir une progéniture et d'avoir eu des enfants. Ces facteurs dits facteurs sociaux dans notre étude n'influencent pas le suivi thérapeutique des PHVVIH et des PVVIH appariées en genre et en âge à l'UPEC de l'HIA. L'intégration sociale étant par définition dans notre étude le fait d'être actif sexuellement, de désirer et d'avoir une progéniture, montre qu'il existerait une corrélation avec la qualité du suivi thérapeutique. Ce qui nous emmènerait à dire que le fait pour la PHVVIH appariée à la PVVIH à être sexuellement active est un des facteurs importants qui influence leur meilleure prise en charge dans les services de PTME et de l'UPEC. Les PHVVIH et les PVVIH qui s'intègrent dans les activités de la PTME ont plus de chance, soit 84% de chance de bénéficier d'une meilleure prise en charge comparé à celles qui ne veulent pas s'intégrer aux activités de la PTME, qui ont plutôt 16% de chance d'être bien suivi. Il en est de même de leur participation aux activités trithérapeutiques du CTA de l'HIA (Tableau 5).
Malgré que notre étude ne vise aucune association possible, nous nous sommes permis de mieux expliquer l'impact de la non-intégration aux activités de PTME chez les PHVVIH et PVVIH sur la qualité de leur prise en charge trithérapeutique à l'aide du Tableau 6. Le risque relatif rapproché montre que les patients sexuellement actifs ont un risque bénéfique de 50% de bénéficier d'un meilleur suivi or ceux qui ne sont pas actifs s'éloignent de cette chance de bénéficier d'un meilleur suivi tri thérapeutique d'au moins 28,57% pour les patients non sexuellement actifs et de 44% pour les patients sexuellement actifs. Les PHVVIH et PVVIH appariées ne désirant pas avoir une progéniture s'éloignent de l'effet bénéfique d'une bonne prise en charge. Les PHVVIH et PVVIH ayant des enfants ou non s'éloignent d'après les résultats d'une meilleure qualité du suivi thérapeutique. En conclusion nous remarquerons que lorsque les PHVVIH ne sont pas sexuellement actives, ne désirent pas avoir une progéniture, n'ont pas d'enfants, ne s'intègrent et ne participent pas dans les activités du CTA elles ont plus de risque de faire face à des effets qui ne vont pas améliorer leur prise en charge tri thérapeutique, par conséquent améliorer leur santé en général et leur santé sexuelle et reproductive en particulier (Tableau 6).
Des inégalités ont été constatées chez les PHVVIH et les PVVIH de l'HIA. Ces inégalités impactent leur santé sexuelle et reproductive. Certaines études menées au Cameroun sur la SSR des jeunes handicapées montrent qu'il existe des inégalités d´accès aux services de SSR. Il s'agissait des limitations scolaires et du manque de travail. Ils constituaient des limites à l'accès au test de VIH et au service de planning familial [1]. Une deuxième étude quantitative menée au Cameroun cette fois sur la PHVVIH a permis de faire ressortir les barrières à la SSR des PHVVIH. Ce sont l'inaccessibilité aux services de SSR et le vécu des violences basées sur le genre. Il est à noter également qu'il n'y a pas assez d'informations sur la PHVVIH. Le manque de données sur la PHVVIH a été un obstacle rencontré notre étude d'où la taille de l'échantillon. L'étude quantitative HandiVIH avait pour but de comprendre la SSR chez les PHVVIH [2]. Notre recherche nous a permis également de comprendre la SSR chez les PHVVIH de l'HIA et les barrières à leur SSR étaient leur statut sérologique VIH positif, le handicap, la qualité de sa SSR, leur désir d'avoir des enfants, le nombre de leur progéniture conçu avant et où après la connaissance du statut sérologique, leur participation sociale et aux activités du CTA de l'HIA, leur rétention des médicaments, leur consommation des ARV à des horaires convenables, leur auto prise en charge du suivi thérapeutique, suivi de charge virale et leur survie aux violences basées sur le genre.
Au Benin le CTA de l'HIA intégré dans le CNHU est financé par le Department of Defense HIV/AIDS Prevention Program (DHAPP). Le DHAPP finance en majorité près de 55 pays africains ayant des hôpitaux militaires dans la prise en charge globale du VIH/SIDA contrairement à certains pays moins développés comme la Tanzanie et le Kenya où l'accès au conseil et au dépistage volontaire du VIH-1 est sévèrement limité comme pays les moins développés [3]. L'étude montre que les PHVVIH ont une forte connaissance du VIH que les PVVIH qui eux également ont une forte proportion de connaissance du VIH. Les pourcentages sont respectivement de 100% et de 93,75%. La proportion des personnes sexuellement actives est plus élevée chez les PHVVIH soit 75% que chez les PVVIH soit 43,75%. Près de 31,25% des PHVVIH utilisent des moyens contraceptifs au détriment de 43,75% chez les PVVIH. Les PHVVIH semblaient avoir une vie sexuelle plus stable et avoir un fort désir d'avoir des enfants et de fonder des familles. Ces PHVVIH avaient des charges virales indétectables et appréciaient positivement la qualité de leur prise en charge trithérapeutique. Ils répondaient au questionnaire avec calme et sérénité. La preuve d'un système de santé organisé et d'une prise en charge globale respectant les objectifs 959595 de l'ONUSIDA.
En Thailand, une étude sur la SSR des adolescents et jeunes vivant avec le VIH appariés en genre et âge avec des adolescents et jeunes sains montre que les cas et les témoins ne différaient pas en termes d'éducation sexuelle, d'initiation sexuelle, de relations amoureuses ou amicales et de comportements à risque. Cependant, les personnes vivant avec un VIH/sida étaient moins susceptibles de fréquenter le système d'éducation (p < 0,01), de planifier le mariage (p < 0,01) ou d'être parents (p < 0,01) [4] (Rolland-Guillard et al.). Au Ghana, une étude explore les services en SSR chez les adolescents et jeunes handicapés et les points forts de cette étude sont des faits que 52,1% de jeunes ont connaissance de la notion de SSR. La plupart des jeunes ont leur première ménorrhée à l'âge de 13 ans et les garçons leur puberté à l'âge de 14 ans. La plupart est informée par leurs enseignants 63,7% et 12,2% par leurs parents. Leur connaissance des méthodes contraceptives est limitée par conséquence par la connaissance du condom comme le moyen contraceptif le plus connu et le plus utilisé [5] (Obasi et al.). En Ethiopie une étude montre que 64,6% de jeunes handicapés ont connaissance de la SSR. Les sources d'informations en Ethiopie sont la radio et la télévision. 96,7% de ces jeunes ont entendu parlé du VIH mais plus de 88% ont une faible connaissance des méthodes de prévention contre le VIH/SIDA. Près de 21,6% ont été à risque du VIH par leur pratique et comportement [6] (Kassa et al.). A Addis Abbaba, 45,4% de jeunes n'ont pas utilisé un moyen contraceptif lors de leur premier rapport sexuel et la proportion des personnes qui ont connaissance du VIH et de sa transmission sont de 55,8%. Ceux qui connaissent les signes et symptômes du VIH sont d'une proportion de 33,1%. Ceux qui connaissent les moyens de prévention sont d'une proportion de 51,5% mais seulement 33,3% de ces jeunes utilisent les services de SSR [7] (Alemu et al.). Nous constatons que de nos jours toutes les couches de la population mondiale ont connaissance du VIH et de ses symptômes, ce qui justifient les bonnes proportions des personnes qui connaissent le VIH au CTA de l'HIA. La proportion de ceux qui utilisent les moyens contraceptifs est sensiblement égale. Les préservatifs féminin et masculin restent le moyen contraceptif le plus connu même au sein de notre population d'étude.
Des chercheurs ont obtenu des résultats selon lesquels l'âge, la religion, les sources d'informations et la tutelle facteurs associés à la SSR impactaient sur la connaissance et l'accès à la compréhension de la SRR et ses services chez les adolescents et jeunes en situation de handicap [5]. A Lusaka en Zambie les femmes handicapées souhaitent vivement avoir des enfants et de l'affection, ce qui peut accroître leur vulnérabilité à l'exploitation sexuelle1. De plus, les croyances traditionnelles sur la transmission des handicaps peuvent créer des obstacles à leur intégration dans les cliniques prénatales. Les prestataires de services de santé supposent souvent que les femmes handicapées ne sont pas sexuellement actives et n'ont donc pas besoin de services de santé reproductive. Cette hypothèse conduit à une vulnérabilité accrue aux infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH. Les déficiences physiques peuvent rendre difficile l'accès des femmes aux établissements de santé, en particulier lorsqu'elles sont orientées vers des maternités tertiaires situées en dehors de leur localité [8] (Smith et al.). Les PHVVIH prises en charge au CTA de l'HIA désirent avoir des enfants comparés au PVVIH dont la proportion de désir d'enfantement était moins élevée que la leur. Les PHVVIH exprimaient un désir de fonder des familles, d'avoir des progénitures et de vivre la vie qu'ils auraient raison de valoriser [9] (Armatya Sen). Les prestataires n'ont aucune idée des désirs pour les PHVVIH d'avoir des enfants puisque la prise en charge ne tient pas compte de cette variable sauf à la demande du (de) la patient(e), d'où sa référence au service de PTME. Nous avons constaté par contre une résilience chez les PHVVIH à accéder aux différents soins et prises en charge thérapeutiques. Tous ont une charge virale indétectable comparée à la proportion des PVVIH liées dans le CTA de l'HIA. La religion ne semble pas impacter dans leur prise en charge et bien qu'étant dans un territoire à fort patrimoine culturel, aucune des PHVVIH et des PVVIH appariées n'a manifesté son intérêt pour la médecine alternative afin de le guérir du VIH/sida.
Une étude menée par l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et l'Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD) au Cameroun montre qu'il existe des facteurs sociaux économiques qui influencent la SSR des personnes handicapées [1] (Debeaudrap et al.). La stigmatisation, le manque d'accès à la SSR et les pratiques inadéquates de la SSR chez les PHVVIH sont des barrières à leur santé sexuelle stipule Rohleder [10]. Au Kenya, les longues distances entre les lieux d'habitation des personnes ayant des maladies liées au VIH/sida et l'hôpital, cause des années de vies perdues [11] (Etyang et al.). Au Nigeria, l'inexistence des programmes de lutte contre le VIH chez les personnes handicapées (PH) et la non implication du gouvernement dans la lutte contre le VIH favorisent la discrimination, le non-respect et les préjugées envers la PHVVIH [12]. La plupart des études sur la personne handicapée et non PVVIH montre que ces femmes handicapées sont discriminées elles n'ont pas accès aux services de SSR ni à l'éducation ni à l'information elles sont marginalisées dans les services de santé et même de justice avec des risques de violence basée sur le genre [13] (Enwereji et al.). En Afrique du Sud les PVVIH ayant des limitations physiques, les problèmes mentaux et qui font face aux préjugées de la société dans laquelle ils vivent sont empêchées d'avoir une santé de qualité et d'améliorer les conditions de leur vie [14] (Hanass-Hancock et al.). L'analyse psychosociale de notre étude révélait que l'âge était une limite pour le désir de procréer et cela pour beaucoup de PVVIH non handicapées qui se trouvaient également être des populations les plus marginalisées et sujettes de discrimination et de préjugés, contrairement à la PHVVIH qui acceptait tant que mal sa maladie et les moyens qui la permettait de vivre sans toutefois tenir compte des discriminations et des préjugées. Peu s'en rendait compte puisqu'elles s'acceptaient à la base et étaient constamment en contact avec leur médecin traitant. Notre cible constituée majoritairement des béninois, togolais, ghanéen et ivoirien n'avait pas de difficulté face à l'accessibilité du centre de traitement mais juste des difficultés financières pour avoir accès à leur prise en charge. La distance n'était pas un problème puisqu'ils arrivaient à respecter leur rendez-vous et tous les PHVVIH de notre cible avait des charges virales (CV) supprimées. Il aurait été intéressant de connaître les pratiques sexuelles de notre cible mais nous nous sommes concentrés sur l'aspect de leur connaissance du VIH, leur choix sur l'utilisation des moyens contraceptifs, le nombre d'enfants acquis, le désir d'en faire et leur connaissance des services de la PTME.
En effet, les résultats de ces études révèlent qu'il n'existe alors aucun effet de médiation pour l'ensemble de ces difficultés sur l'amélioration de la SSR de la personne handicapée en général et de la PHVVIH en particulier. Ces études mettent ainsi en évidence la nécessité d'interventions ciblées pour surmonter les obstacles socioéconomiques et améliorer leur accès aux services de SSR pour les personnes handicapées [1,2]. Les PHVVIH et les PVVIH appariés ne diffèrent pas substantiellement des témoins en termes de vie sexuelle et sociale. Pourtant, les politiques d'action positive pourraient aider à gérer leur SSR en lien avec leur handicap. La fourniture d'un soutien psychosocial pourrait améliorer leur capacité à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne la formation de la famille [4] (Roland Guillard et al.). Le système de santé devrait être responsable des besoins de la jeune femme handicapée en Uganda qui est violentée, exposée, exclue et discriminée des services de SSR ce qui l'expose au VIH/sida [15] (Nampewo). D'où le besoin d'inclure un système d'éducation sur la SSR chez les jeunes handicapés dans 3 villes de l'Afrique du Sud afin de leur garantir une meilleure vie sexuelle et reproductive [16] (Wazakili et al.). Notre étude dans le CTA de l'HIA a permis de collecter des données quantitatives susceptibles de mettre en évidence des interventions ciblées autour de la PHVVIH. Nous avons remarqué que la PHVVIH faisait face à une résilience face au VIH, son handicap et tous les facteurs sociaux. Ces facteurs sociaux étaient la qualité de sa SSR, son désir d'avoir des enfants, le nombre de progéniture conçu avant et où après la connaissance de son statut sérologique, sa participation sociale et aux activités du CTA de l'HIA, venir à la rétention des médicaments, consommer ses ARV convenablement, faire son suivi thérapeutique, faire le suivi de sa charge virale et survivre aux violences basées sur le genre. Le système de santé semble être responsable. D'une manière inconsciente comme le définit Armatya Sen, le système de santé béninois appliqué au CTA de l'HIA facilite et aide les PHVVIH à vivre la vie qu'elles auraient raison de valoriser [9]. La PHVVIH et la PVVIH appariée ont plus de chance de bénéficier d'un meilleur suivi thérapeutique si elles fréquentent et font la demande des services de PTME. Elles ont également plus de chance d'en bénéficier lorsqu'elles participent à toutes les activités liées au CTA dans lequel elles ont été liées tout en survivant aux VBG.
La PHVVIH a des besoins satisfaits et non satisfaits en SSR tout comme les personnes normales. La plupart des PHVVIH ayant connaissance de leur handicap, de leur statut sérologique positif au VIH, des facteurs sociaux liés au choix de leurs moyens contraceptifs, des préjugés et de la stigmatisation dont elles faisaient preuve acceptaient leur condition tout en développant une résilience. Cette résilience allait leur permettre d'améliorer leur santé sexuelle et reproductive. Nous remarquerons que lorsque les PHVVIH et les PVVIH appariées n'étaient pas sexuellement actives, ne désiraient pas avoir une progéniture, n'avaient pas d'enfants, ne s'intégraient pas et ne participaient pas aux activités de l'unité de prise en charge de l'Hôpital des Instructions Armées de Cotonou, elles avaient plus de risque de faire face à des effets qui ne pouvaient pas améliorer leur prise en charge trithérapeutique, par conséquent améliorer leur santé en général et leur santé sexuelle et reproductive en particulier. Les barrières à la SSR des PHVVIH étaient leur statut sérologique VIH positif, leur handicap, la qualité de leur santé sexuelle et reproductive, leur désir d'avoir des enfants, le nombre de leur progéniture conçu avant et après la connaissance du statut sérologique, leur participation sociale aux activités du CTA de l'HIA, leur rétention des médicaments, leur consommation des ARV à des horaires convenables, leur autoprise en charge du suivi thérapeutique, leur suivi de charge virale et survie aux violences basées sur le genre. Néanmoins, la PHVVIH s'intégrait et participait aux activités du CTA de l'HIA avec un désir de fonder un foyer avec un partenaire qui accepterait son statut sérologique et d'avoir des progénitures malgré le VIH et son handicap. Les informations collectées montrent que l'ensemble des PHVVIH qui ont participé à l'étude se prennent mieux en charge que les PVVIH, ont une meilleure connaissance du VIH, des moyens de contraception pour éviter toute co-infection. Peu de PHVVIH étudiées utilisent les préservatifs avec leur partenaire, choix justifié par le désir de fonder des familles et de vivre la vie qu'elles auraient raison de valoriser comme le définit le concept armatyasien. Elles ont conscience de l'importance d'avoir une bonne santé par conséquent une bonne valeur de charge virale. Toutes les PHVVIH de notre cible avaient une charge virale supprimée comparé à celle des PVVIH. Le système de santé du Bénin au travers de la mise en place d'un personnel soignant de qualité, facilite et aide les PHVVIH dans la prise en charge de leur santé sexuelle et reproductive. Il serait néanmoins susceptible dans les années à venir de mettre en évidence des interventions hautement ciblées autour de la PHVVIH afin de leur assurer une meilleure prise en charge dans les services PTME, planning familial et de SSR.
Etat des connaissances sur le sujet
- La personne handicapée et vivante avec le VIH a également des besoins en termes de santé sexuelle et reproductive;
- Il serait important de mettre en évidence des interventions hautement ciblées afin d'améliorer la santé sexuelle et reproductive de la personne en situation de handicap.
Contribution de notre étude à la connaissance
- Evaluer les variables liées à la vie sexuelle et reproductive de la PHVVIH et de la PVVIH appariée;
- Etudier la volonté des PHVVIH à vivre la vie que chacune des populations de notre étude souhaitaient vivre, favorisant ainsi une vie sexuelle et reproductive saine et épanouie;
- Améliorer l'indicateur suivi thérapeutique, indispensable dans la compréhension de la réponse des PHVVIH et des PVVIH face au VIH et à leur handicap.
Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts.
Alvine Stéphanie Nteppe, est l'auteure principale dans l'élaboration du thème de thèse, l'élaboration des outils de recherche, la mise en œuvre du projet, son analyse et la valorisation de ses résultats. Principale enquêtrice qualitative et quantitative des données. Vincent Tiffreau et Paraïso Noël Moussiliou ont aidé à la conceptualisation du thème de thèse et à la validation des différentes autorisations éthiques. Leur apport est marqué dans tous les processus d'élaboration, de mise en œuvre et d'analyse des données du projet.
Nos remerciements reviennent aux patients, personnels, points focaux des unités de prise en charge du VIH de l'Hôpital d'Instructions Armées de Cotonou et de l'Hôpital militaire de région 2 de Douala pour leur disponibilité et participation à l'étude mixte. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de l'Union des Etudes pour la Population Africaine (UEPA) et au HDCA qui à travers leur point focal sur l'étude sur l'approche par les capabilités nous ont soutenu techniquement et financièrement aux différentes conférences afin de valoriser les résultats de notre recherche de thèse.
Tableau 1: connaissance SSR des PVVIH dans le CTA de l'HIA
Tableau 2: nombre d'enfant des PVVIH
Tableau 3: connaissance SSR des PHVVIH dans le CTA de l'HIA
Tableau 4: nombre d'enfant des PHVVIH
Tableau 5: facteurs sociaux en santé sexuelle reproductive associés au suivi thérapeutique (N=32)
Tableau 6: facteurs sociaux associés au suivi thérapeutique (N=32)
- DeBeaudrap P, Mouté C, Pasquier E, Mac-Seing M, Mukangwije PU, Beninguisse G. Disability and Access to Sexual and Reproductive Health Services in Cameroon: A Mediation Analysis of the Role of Socioeconomic Factors. Int J Environ Res Public Health. 2019 Feb 1;16(3):417. PubMed | Google Scholar
- De Beaudrap P, Pasquier E, Tchoumkeu A, Touko A, Essomba F, Brus A et al. HandiVIH--A population-based survey to understand the vulnerability of people with disabilities to HIV and other sexual and reproductive health problems in Cameroon: protocol and methodological considerations. BMJ Open. 2016 Feb 4;6(2):e008934. PubMed | Google Scholar
- Sweat M, Gregorich S, Sangiwa G, Furlonge C, Balmer D, Kamenga C, Grinstead O, Coates T. Cost-effectiveness of voluntary HIV-1 counselling and testing in reducing sexual transmission of HIV-1 in Kenya and Tanzania. Lancet. 2000 Jul 8;356(9224):113-21. PubMed | Google Scholar
- Rolland-Guillard L, de La Rochebrochard E, Sirirungsi W, Kanabkaew C, Breton D, Le Cœur S. Reproductive health, social life and plans for the future of adolescents growing-up with HIV: a case-control study in Thailand. AIDS Care. 2019 Jan;31(1):90-94. PubMed | Google Scholar
- Obasi M, Manortey S, Kyei KA, Addo MK, Talboys S, Gay L et al. Sexual and reproductive health of adolescents in schools for people with disabilities. Pan Afr Med J. 2019 Aug 14;33:299. PubMed | Google Scholar
- Kassa TA, Luck T, Bekele A, Riedel-Heller SG. Sexual and reproductive health of young people with disability in Ethiopia: a study on knowledge, attitude and practice: a cross-sectional study. Global Health. 2016 Feb 10;12:5. PubMed | Google Scholar
- Alemu T, Fantahun M. Sexual and reproductive health status and related problems of young people with disabilities in selected associations of people with disability, Addis Ababa, Ethiopia. Ethiop Med J. 2011 Apr;49(2):97-108. PubMed | Google Scholar
- Smith E, Murray SF, Yousafzai AK, Kasonka L. Barriers to accessing safe motherhood and reproductive health services: the situation of women with disabilities in Lusaka, Zambia. Disabil Rehabil. 2004 Jan 21;26(2):121-7. PubMed | Google Scholar
- Armatya S. Well-Being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984. The Journal of Philosophy. Apr 1985;82(4):169-221. Google Scholar
- Rohleder P. Disability and HIV in Africa: Breaking the barriers to sexual health care. J Health Psychol. 2017 Sep;22(11):1405-1414. PubMed | Google Scholar
- Etyang AO, Munge K, Bunyasi EW, Matata L, Ndila C, Kapesa S et al. Burden of disease in adults admitted to hospital in a rural region of coastal Kenya: an analysis of data from linked clinical and demographic surveillance systems. Lancet Glob Health. 2014 Apr;2(4):e216-24. PubMed | Google Scholar
- Sundby J. Are women disfavoured in the estimation of disability adjusted life years and the global burden of disease? Scand J Public Health. 1999 Dec;27(4):279-85. PubMed | Google Scholar
- Enwereji EE, Enwereji KO. Disabled persons and HIV/AIDS prevention: a case study of deaf and leprosy persons in Nigeria. East Afr J Public Health. 2008 Aug;5(2):55-61. PubMed | Google Scholar
- Hanass-Hancock J, Myezwa H, Nixon SA, Gibbs A. "When I was no longer able to see and walk, that is when I was affected most": experiences of disability in people living with HIV in South Africa. Disabil Rehabil. 2015;37(22):2051-60. PubMed | Google Scholar
- Nampewo Z. Young women with disabilities and access to HIV/AIDS interventions in Uganda. Reprod Health Matters. 2017 May;25(50):121-127. PubMed | Google Scholar
- Wazakili M, Mpofu R, Devlieger P. Should issues of sexuality and HIV and AIDS be a rehabilitation concern? The voices of young South Africans with physical disabilities. Disabil Rehabil. 2009;31(1):32-41. PubMed | Google Scholar